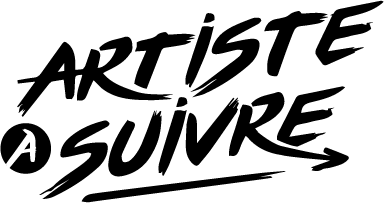Entre Paris, Londres et la Californie, SALYA construit une œuvre à l’image de son parcours : libre, mouvante et profondément sincère.
Ancienne étudiante de Sciences Po passée par Columbia, elle a tout quitté pour suivre une intuition, celle de la musique, viscérale et nécessaire. Dans ses chansons, l’amour côtoie la mélancolie, la lumière flirte avec la peine, et chaque note traduit ce tiraillement entre force et fragilité. Artiste à Suivre l’a rencontrée pour une conversation sans détour, où il est question de liberté, de renaissance et de ce moment précis où l’on ose tout risquer.
AAS : C’est notre première rencontre, pour celles et ceux qui te découvrent peux-tu te présenter ?
SALYA : Je suis née en banlieue parisienne, je viens de Noisy-le-Grand. J’ai fait des études en arbitrage international et en business jusqu’à un master 2. Pendant longtemps, c’est ce rêve académique qui m’a défini, mais la musique a toujours fait partie de ma vie. Je chantais pour moi, mais je ne m’étais jamais autorisée à rêver de le faire sérieusement. Et par la suite, je me suis lancée totalement dans la musique. J’ai vraiment fait le grand saut dans le vide. Et depuis quelques années maintenant, je ne fais presque que ça. Donc je suis un peu passée du tout au tout. Mais, la musique, a toujours été présente.
AAS : À quel moment ça bascule en fait ? Tu n’as pas fait ces études pour te dire du jour au lendemain je fais de la musique ? Comment ça s’est passé ?
SALYA : Je pense que c’est une accumulation, plein de petits signes que j’ignorais. La musique, elle était là depuis le tout début, parce que ma mère est passionnée de Marvin Gaye, des Cranberries, de Ben Harper, de Lenny Kravitz. C’était une culture très anglo-américaine à la maison. Elle m’a inscrite au conservatoire quand j’étais jeune : j’ai fait du piano, du chant lyrique, de la danse classique, et même du solfège. Je n’étais pas passionnée par le piano, mais j’adorais le chant. Je passais des heures devant des vidéos YouTube d’artistes comme Christina Aguilera, à apprendre leurs chansons. Je chantais en anglais avant de savoir parler anglais.
Ma mère rêvait de nous offrir à ma soeur et moi ce dont elle avait manqué enfant : l’accès à des cours de musique et de danse. Elle vient d’un milieu modeste et rêvait d’être chanteuse. Je ne l’ai appris que récemment, parce qu’elle ne voulait pas que ça m’influence. Donc déjà, merci maman pour ça!
Ensuite, j’ai poursuivi mes études parce que l’école représentait l’ascenseur social par excellence, c’est comme ça que mes parents me l’avaient toujours présenté. C’était leur rêve que je fasse de grandes études, et c’est devenu le mien. Mais pendant tout ce parcours académique, la musique revenait toujours. À 14 ans, j’ai participé à un concours à Noisy-le-Grand, Jeunes en scène. Il fallait avoir 16 ans, j’ai menti, j’ai dit que j’en avais 16, et j’ai été prise. C’était ma première scène, j’ai adoré. Des amis de ma mère me disaient que je devais continuer, mais je ne les écoutais pas. C’était trop incertain. Je ne connaissais personne dans ce milieu, je ne savais pas comment faire. Et puis j’avais le sentiment que c’était un luxe financier que je ne pouvais pas m’offrir.
Ce qui m’a vraiment fait décrocher, c’est mes stages avocat. J’avais choisi mon master en droit économique une heure avant la date limite tellement j’étais indécise et je n’ai vraiment pas aimé la pratique du métier en stage. Puis je suis partie à New York, où j’ai fait ma dernière année d’étude. Je savais déjà à ce moment-là que je voulais me lancer dans la musique, mais ma mère voulait que j’aille au bout de mes études, donc c’est ce que j’ai fait. Et j’en suis heureuse car j’ai adoré New York. Je n’ai jamais été aussi heureuse que là-bas. J’y ai rencontré plein d’artistes. Malgré ses travers, le mindset du rêve américain m’a permis de respirer à nouveau. Je me suis dit : “Ah, c’est possible.” Je me suis autorisée à rêver à nouveau.
Je suis rentrée à Paris, j’ai eu mon diplôme, et puis c’était le confinement. Le moment parfait. J’ai commandé tout le matériel de prod et, pendant un an, j’ai appris à composer et produire sur mon ordi dans ma chambre à Noisy. J’ai écrit une quantité de chansons nulles, pour réussir à en écrire quelques-unes de bonnes. Par contre, tu passes de New York à Noisy-le-Grand et confiné… ça fait mal. (Rires)

AAS : En 2023, tu lances un premier single Extraordinaires un single en français Comment ça s’est fait ?
SALYA : Oui, Extraordinaires c’est le premier single que j’ai sorti. À ce moment-là, je venais de signer avec un label en France. C’est le premier morceau où le français m’est venu naturellement, alors que je composais d’habitude en anglais. Mon entourage professionnel m’encourageait à écrire en français, car c’était plus simple à défendre, et ils avaient raison. Mais pour moi, ce n’était pas évident, parce que j’avais grandi avec une culture musicale très anglo-saxonne. Je sais aujourd’hui qu’il faut créer ce qui te vient naturellement et ne pas travestir tes premiers instincts, mais c’est une leçon que j’ai dû apprendre.
J’avais déjà écrit mon premier projet, un EP en deux parties, avant même de signer. C’est ce qui est sorti ensuite.Quand je réécoute La peine, ça me touche encore. Je me souviens du moment où je l’ai écrite, à quel point je me sentais perdue. J’étais passée d’un monde à un autre. Mes amis de l’école n’ont pas compris lorsque j’ai décidé de me lancer dans la musique, et j’en ai gardé très peu. Ils ont continué leur route, et j’ai changé de chemin. Tu te sens seul, à la dérive, sans savoir si tu fais une erreur. Mais il faut suivre son instinct.
Visuellement, je ne m’étais pas encore trouvée et je n’ai pas forcément eu l’espace pour me chercher. J’étais très naïve et j’ai découvert la complexité du développement d’un projet émergent en major. Je suis heureuse d’avoir eu cette expérience, dont je garde de bons souvenirs. J’ai beaucoup appris sur ce que je voulais être et ce que je ne voulais pas être. J’ai préféré le live, et l’opportunité d’ouvrir une fois pour des plus gros artistes, comme Pierre de Maere et Adèle Castillon.
Ensuite, j’ai dû commencé à travailler sur le projet suivant. Le label m’a mise en session avec des producteurs à Paris. C’était la première fois que je créais vraiment à quatre mains, dès le début d’un morceau. Avant, je faisais tout seule. J’ai rencontré beaucoup de prods talentueux, mais je composais toujours en anglais, je ne voulais plus franciser et je ne trouvais pas le grain que je recherchais à Paris. C’est à ce moment-là que j’ai rencontré mon producteur Jules Apollinaire, à Londres. Et là, coup de coeur total, humain et artistique. J’avais enfin trouvé le partenaire musical que j’attendais depuis longtemps. Avec lui, j’ai pu tester, explorer, chercher. Il m’a donné confiance en moi en tant que productrice, et pas seulement comme songwriter, et m’a fait totalement repenser la manière dont j’approchais le métier d’artiste.

AAS : Tu partages ton temps entre Paris et Londres. Qu’est-ce que tu trouves de différent dans ton processus créatif aujourd’hui ? Qu’est-ce que tu gagnes à Londres, que tu n’as pas trouvé ici en France ?
SALYA : L’endroit où tu crées influence forcément ta musique. J’ai aussi eu la chance de travailler en Californie, dans le désert de Joshua Tree. Le son n’est pas le même : l’espace, la lumière, tout change. Tu es influencé par ton environnement. À Londres, j’ai trouvé que les artistes étaient plus libres dans leur manière de créer. C’est plus rock’n’roll. Ils osent tout, sans chercher à lisser. Leur approche est plus brute, plus libre, et c’est exactement ce que je cherchais. Cette liberté, je l’ai ressentie immédiatement. Dans ma vie, la liberté a toujours été un fil rouge et une quête : s’extraire de sa condition, de croyances transmises, du regard des autres. Gagner sa vie pour gagner du temps, puis du temps pour créer. La musique, c’est un luxe, un privilège. Tout le monde n’a pas cette chance. Et puis, c’est aussi la liberté d’être plurielle.
AAS : Ta musique navigue entre pop solaire et mélancolie immédiate. Comment tu définirais ton univers sans chercher à le mettre dans une case ?
SALYA : Je veux que ma musique reste libre, qu’elle respire. Je ne refuse pas d’être définie, seulement d’être limitée. Du coup c’est une musique qui navigue naturellement entre des ballades mélancoliques et des titres pop plus entraînants et pleins d’espoir, parce que c’est vraiment ce que je vis au quotidien. J’aimerais parfois être plus mesurée mais ce n’est pas moi. Je navigue entre des moments où je suis profondément heureuse et d’autres où j’ai besoin de la musique pour respirer.
Le métier d’artiste, c’est un chemin solitaire, beaucoup plus dur que ce que j’imaginais. Heureusement que je ne le savais pas, sinon je ne me serais peut-être jamais lancée. Ma vie, comme ma musique, oscille entre des sommets et des creux. Les moments heureux, je les vis intensément, ce sont des instants solaires, des moments à la Caroline Polachek, où tout semble possible, comme dans le désert californien, l’horizon infini, rien ne t’arrête. Et puis il y a les moments plus sombres, ceux qui suivent une rupture ou une perte, ou un retour au RER A, à Noisy-le-Grand, après avoir vécu à New York City.. Ces deux états sont très différents, presque opposés, mais ils ne s’annulent pas. Au contraire, ils se complètent. Tu ne peux pas connaître les très hauts sans avoir traversé les très bas. L’un n’existe pas sans l’autre.

AAS : Aujourd’hui, la scène est saturée d’artistes émergents. Pour toi, où se situent les vraies difficultés ?
SALYA : La plus grande difficulté, c’est d’exister dans un marché saturé. Pour qu’on t’identifie, il faut être identifiable. Et pour être identifiable, il faut une singularité forte, presque une marque. C’est paradoxal, parce que pour se démarquer, il faut souvent se limiter. Or, un artiste n’est pas censé être limité. On te pousse à te définir par une seule image, une seule couleur, une seule coupe de cheveux. La création, pour moi, ne peut exister que dans la liberté. Et c’est difficile, parce qu’on demande à quelqu’un qui, par nature, est infini, de se réduire pour être compris. Il faut se simplifier, presque se formater. Alors oui, on peut le voir comme une opportunité de focus, mais il ne faut pas trop se restreindre non plus. Sinon, quand tu veux évoluer, les gens ne te suivent plus : “Ah bon ? Mais t’étais pas ça avant !”
C’est d’ailleurs pour ça que j’ai choisi de chanter en anglais dès le départ, même si l’essentiel des chansons était en français. Mon entourage me disait : “Perce d’abord en français, et ensuite tu pourras aller à l’international.” Mais non. Il faut être qui tu veux être dès le début. Changer de direction artistique plus tard, c’est beaucoup plus compliqué et tu ne fais pas ce que tu aimes. Je pense que c’est la plus grande difficulté aujourd’hui : trouver ton identité sans t’enfermer dedans. Et puis, un artiste, aujourd’hui, ne fait plus que de la musique. Tu dois te marketer, tourner tes vidéos, gérer ta promo, te vendre sur les réseaux. C’est plus du marketing que de la musique. Et c’est dommage, parce que la musique devrait redevenir le centre de tout. Mais pour l’instant, il faut composer avec ça.
AAS : Tes chansons parlent beaucoup d’amour… mais pas que. Tu peux nous en parler ?
SALYA : Je parle beaucoup d’amour, oui, parce que c’est ce qui m’inspire le plus. Mais mes chansons ne parlent pas que de çà. Je parle aussi de ce besoin d’émancipation, de cette envie d’aller loin, de se dépasser, de s’extraire de sa condition.
Et puis, il y a un autre thème qui revient souvent : la liberté. Je suis très old-fashioned dans le sens où je reste une amoureuse de l’amour, mais je refuse de rester dans une situation qui me fait du mal. Que ce soit en amour, dans la vie ou dans le travail, quand quelque chose devient toxique, je pars. On n’a qu’une vie, il y a trop de choses à vivre pour se perdre dans ce qui ne nous rend pas heureux.
Je peux me battre jusqu’au bout pour ce que j’aime, pour quelqu’un que j’aime, mais quand je comprends que ce n’est plus possible, je me choisis moi. J’ai beaucoup d’amies qui sont fiancées ou mariées. Je ne m’y retrouve pas forcément : je me sens très libre. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas aimer, simplement, je crois que l’amour, ça te trouve, tu ne le cherches pas. Même quand certaines expériences laissent des traces, je garde le cœur ouvert. Et j’encourage vraiment les filles à faire pareil : à se choisir, à ne pas rester dans une relation qui les abîme. Pour un mec en plus… non merci ! (Rires)
AAS : Risk It, ton dernier single, sonne comme une prise de vertige. Que voulais-tu transmettre à ce moment-là ?
SALYA : J’adore cette chanson. Tous les nouveaux titres sont nés d’une période très particulière : j’avais renoué avec mon tout premier amour à un moment où je me sentais un peu perdue, et lui aussi. On s’est retrouvés dans cette période de flou, et ça m’a apporté une forme de réconfort. Puis ça s’est terminé, brutalement. C’était très douloureux mais nécessaire. Et littéralement le lendemain de la rupture, je partais à Los Angeles pour la première fois.
Peu après, j’ai quitté mon label. Tout s’effondrait et renaissait en même temps. C’’est dans ce contexte chaotique mais inspirant que j’ai écrit la plupart des chansons du projet qui arrive. Une rupture amoureuse, une rupture professionnelle, un départ dans l’inconnu. Risk It parle de ça : de l’élan, du doute, du fait d’aimer encore alors qu’on sait que ça peut faire mal. J’étais triste, mais au lieu de rester dans la mélancolie, j’ai préféré le prendre avec légereté et humour. C’est une chanson qui dit : “oh well another one.” Parce qu’au fond, il y a toujours quelque chose de drôle dans nos histoires d’amour ratées. Le morceau parle aussi de ce qu’on appelle une situationship, une relation qui n’en est pas vraiment une, où rien n’est clair.
Musicalement, le morceau est lumineux, presque dansant. Sauf sur la fin, que j’ai enregistré seule, tard la nuit. J’avais encore trop d’énergie, trop de choses à dire. J’ai improvisé la prise du pont. Et c’est celle qu’on a gardée. J’aime ce passage, parce qu’il est sincère et instinctif. C’est une envolée lyrique, qui part un peu dans tous les sens vocalement. C’est l’influence de la chanteuse des Cranberries.C’est une immense référence pour moi, et c’est quelque chose qui revient souvent sans que je le cherche vraiment.
AAS : La suite de tes projets, Salya, tu nous en parles ?
SALYA : On a d’autres singles qui vont sortir dans les prochains mois. Ils rejoindront un long EP prévu normalement pour mars-avril 2026, selon les opportunités. Je viens d’ailleurs de vivre un nouveau “coup de tête réfléchi” : je suis partie en Californie avec l’une de mes meilleures amies, Inès Ziouane, une photographe super talentueuse. On partage beaucoup de références, les mêmes rêves d’émancipation et cette envie commune de s’élever socialement, de ne pas être défini par d’où l’on vient. Inès était déjà partie en Californie il y a treize ans et rêvait d’y retourner.
Moi, j’y avais enregistré deux titres qui feront partie du projet Hoping et Blue For You mes préférés. Je voulais retrouver ces paysages, cette lumière, pour tourner des visuels dans le désert et à Los Angeles. C’est une esthétique qui me parle depuis toujours : David Lynch, Twin Peaks, cette étrangeté un peu mystique et cinématographique. On a passé une semaine là-bas, dans un motel différent chaque jour, entre le désert et la ville. On a roulé des heures à Los Angeles et sur les routes du désert, c’était incroyable. J’avais l’impression qu’on pouvait tout recommencer là-bas
C’est ce qui arrive pour la suite : un projet pensé comme un film, entre la route, le rêve et la liberté.
En concert le 12 novembre à Supersonic-records / Première partie de Roller Derby